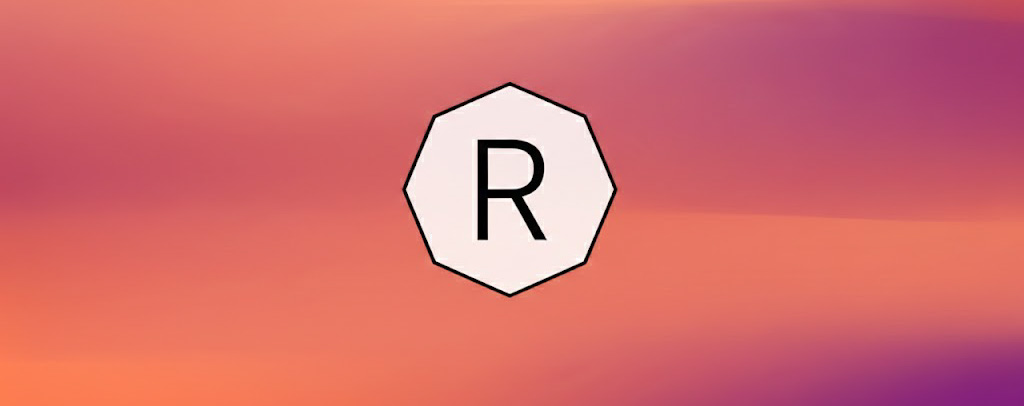Le 6 mai 2025, dans le cadre inspirant de la Villa Arson à Nice, nous avons assisté à une soirée dédiée aux sciences et technologies quantiques. Organisée en partenariat avec la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, la Fondation Université Côte d’Azur et France Deeptech, cette conférence ambitieuse a permis de faire dialoguer recherche fondamentale, entrepreneuriat technologique et perspectives industrielles.
Dans ce lieu chargé d’histoire — récemment inscrit aux monuments historiques — qui incarne à la fois l’avant-garde artistique et l’expérimentation pédagogique, la science quantique a trouvé un terrain d’expression inattendu, mais éminemment pertinent. Car si le quantique bouleverse les paradigmes classiques de la physique, il en appelle aussi à une reconfiguration des relations entre disciplines, entre acteurs publics et privés, entre intuition et rigueur. La soirée s’est déroulée en deux temps. D’abord la présentation de quatre doctorants dans le cadre du concours « Ma thèse en 180 secondes ». Puis une table ronde de haut niveau intitulée « En route vers le quantique : entre promesses et réalité », réunissant chercheurs, entrepreneurs et décideurs publics. Le tout orchestré avec une énergie fédératrice par Michel de Lempdes, président de France Deeptech, maître de cérémonie aussi pédagogue qu’audacieux.
Dès l’introduction, le directeur de la Villa Arson, a rappelé l’importance de ce lieu dans la transmission des savoirs et la création contemporaine. Lieu de recherche, d’expérimentation et de confrontation d’idées, la Villa Arson se veut un incubateur de regards croisés, un terrain d’hybridation entre arts, sciences et société. En accueillant cette conférence sur les technologies quantiques, elle confirme son rôle de passeur entre mondes académiques et mutations du réel. Sylvain Antoniotti, vice-président de l’Université Côte d’Azur, a ensuite pris la parole pour situer l’événement dans le contexte plus large d’une université tournée vers les grands défis contemporains. L’UCA, labellisée Initiative d’Excellence, entend jouer un rôle structurant dans l’écosystème de l’innovation française et européenne, notamment en matière de deeptech et de technologies quantiques, qui redessinent les frontières du possible scientifique.
Puis, place aux jeunes chercheurs. L’épreuve de « Ma thèse en 180 secondes » a vu défiler quatre doctorants d’exception, capables de transformer la complexité scientifique en narration captivante. Une performance à la fois intellectuelle et scénique.
La première intervenante a utilisé l’univers de Super Mario pour illustrer la transition de la chimie médicinale vers la tridimensionnalité. Là où les molécules classiques sont encore pensées en 2D, elle développe une méthode innovante de synthèse de structures complexes en 3D, grâce à un catalyseur à base d’or. Une « révolution moléculaire » visant à élargir les bibliothèques chimiques pour concevoir les médicaments du futur. À travers la métaphore ludique du champignon doré, elle a su rendre accessible une recherche à fort potentiel pharmaceutique.
La deuxième thèse a entraîné le public sous l’eau. L’objectif : remplacer les ondes acoustiques, perturbatrices pour la faune marine, par des ondes lumineuses dans les communications subaquatiques. La doctorante conçoit des micro-LED émettant dans l’ultraviolet, utilisant le nitrure de gallium enrichi en aluminium. L’un des défis majeurs réside dans la fragilité de ces structures, que la chercheuse tente de stabiliser par des architectures bio-inspirées. Un enjeu à la croisée de l’ingénierie, de l’écologie et de l’optique.
La troisième candidate a proposé une plongée dans l’électrolyse solaire. Son ambition : produire de l’hydrogène vert à partir de nanofils semi-conducteurs composés d’indium, de gallium et d’azote. Ces fils, une fois exposés à une lumière proche de celle du soleil, génèrent un champ électrique capable de dissocier les molécules d’eau. Une technologie prometteuse, encore en phase de maturation, mais déjà porteuse d’une vision énergétique renouvelée.
Enfin, la quatrième présentation a déplacé les regards vers le cosmos. En se concentrant sur Bételgeuse, une étoile géante en fin de vie, le doctorant développe des techniques d’interférométrie optique à très haute résolution, exploitant les fibres optiques pour simuler un télescope géant. En connectant deux instruments distants, elle cherche à créer un télescope virtuel de la taille d’un continent. Une révolution dans l’astrophysique d’observation, et un pas de plus vers une compréhension fine des cycles stellaires.
Chacune de ces interventions, bien que thématiquement différentes, témoignait d’un même mouvement : celui de la science en transition, de la nécessité d’élargir les cadres méthodologiques et conceptuels, de se projeter au-delà des paradigmes établis.
La seconde partie de la soirée a été consacrée à une table ronde, dont le titre — « En route vers le quantique : entre promesses et réalité » — posait d’emblée le cadre d’un dialogue équilibré. Autour de Michel de Lempdes, six intervenants issus de la recherche et de l’industrie ont offert un panorama lucide des enjeux actuels des technologies quantiques.
Sébastien Tanzilli, directeur de recherche au CNRS et co-responsable d’un programme de la stratégie nationale quantique, a retracé les fondements de l’information quantique : superposition, intrication, codage par qubits. Il a insisté sur les piliers technologiques du secteur — calcul, simulation, communication, métrologie — tout en soulignant les défis persistants : la décohérence des qubits, la correction d’erreurs, la stabilisation des architectures.
Olivier Ezratty, consultant indépendant et cofondateur de la Quantum Energy Initiative, a apporté un regard synthétique et comparatif sur les différentes approches techniques : photons, ions piégés, supraconducteurs, atomes neutres. Chacune de ces technologies présente des propriétés spécifiques, des coûts, des perspectives d’échelle et des maturités variables. Ezratty a aussi mis en garde contre les effets de mode et les extrapolations hasardeuses : si le potentiel du quantique est réel, sa temporalité sera longue, son intégration progressive.
Sabine Maire, du GENCI (Grand Équipement National de Calcul Intensif), a présenté la politique de commande publique en matière de quantique. Dans le cadre du programme HQI, le GENCI investit dans des prototypes d’ordinateurs quantiques intégrés dans des centres de calcul, avec pour objectif de tester leur robustesse et leur couplage avec les supercalculateurs classiques. La France, pionnière dans ce domaine au niveau européen, explore ainsi les conditions d’un calcul hybride à grande échelle.
Valérian Giesz, cofondateur de la start-up Quandela, a témoigné du dynamisme industriel français. Spécialisée dans les ordinateurs quantiques photoniques, Quandela propose déjà des machines disponibles en cloud et travaille en partenariat avec de grands groupes industriels, de l’énergie à la mobilité. Giesz a défendu un modèle d’innovation pragmatique, articulant recherche académique et cas d’usage, avec une obsession : rendre le quantique accessible aux utilisateurs finaux, développeurs et entreprises.
Charles Praud, directeur du développement quantique chez SopraSteria, a mis en lumière le rôle stratégique des entreprises de services numériques. Dans un futur proche, les architectures informatiques seront nécessairement hétérogènes : CPU, GPU, et processeurs quantiques coexisteront au sein d’infrastructures intégrées. Les ESN, par leur capacité à assembler ces briques technologiques et à adapter les logiciels aux besoins métiers, joueront un rôle clé dans la démocratisation du quantique.
Au fil des échanges, plusieurs thématiques transversales ont émergé. D’abord, l’importance d’une hybridation raisonnée entre calcul classique et quantique : l’ordinateur quantique ne remplacera pas le classique, il viendra en appui, sur des tâches spécifiques. Ensuite, la question cruciale des cas d’usage : si certaines applications comme la simulation de molécules semblent prometteuses à court terme, d’autres (comme l’optimisation combinatoire ou la cryptographie post-quantique) nécessitent encore des avancées technologiques majeures.
L’un des points saillants de la discussion a été la tension entre promesse technologique et réalité économique. Ezratty a rappelé que certaines projections économiques (jusqu’à 1000 milliards de dollars de valeur créée d’ici 2040) relèvent davantage du storytelling que de l’analyse rigoureuse. Il a plaidé pour une approche fondée sur le retour sur investissement (ROI), évaluant les coûts d’infrastructure, les performances, mais aussi l’impact environnemental des solutions proposées.
Enfin, tous ont souligné l’importance de la formation et du décloisonnement des compétences. Le quantique ne pourra se déployer sans une ingénierie nouvelle, réunissant physiciens, informaticiens, ingénieurs systèmes, développeurs, experts métier. L’avenir de cette technologie repose autant sur ses avancées théoriques que sur sa capacité à s’insérer dans les processus industriels existants.
L’exemple de Quandela est à ce titre emblématique. Partie d’un laboratoire de physique fondamentale, l’entreprise regroupe aujourd’hui des profils variés — physiciens, ingénieurs, informaticiens — pour produire un ordinateur « full stack » destiné à un usage réel. Sa stratégie repose sur l’accessibilité (accès cloud), la collaboration (avec l’industrie et les centres de calcul) et l’internationalisation. Le fait qu’elle ait remporté un appel d’offres européen dans un marché concurrentiel valide la qualité de son approche.
Au-delà des performances technologiques, c’est une question d’écosystème qui s’est imposée tout au long de la soirée. L’unanimité des intervenants a confirmé que la France et plus largement l’Europe, dispose d’un socle scientifique robuste, d’un vivier entrepreneurial dynamique, et d’un cadre public structurant. Mais l’avantage compétitif ne se maintiendra que si les financements perdurent, si les formations s’intensifient, et si les collaborations entre acteurs académiques et industriels se multiplient.
En clôture, Michel de Lempdes a rappelé l’enjeu sociétal de cette transition : ne pas répéter les erreurs du passé. « Avec l’internet, les microprocesseurs, les GAFA, l’Europe a souvent joué en second rideau. Cette fois, nous avons une fenêtre de tir. À nous de la saisir collectivement. »
Dans le clair-obscur de l’amphithéâtre de la Villa Arson, une chose est apparue avec netteté : le quantique n’est plus une affaire de science-fiction. Il est en train de devenir un enjeu stratégique, industriel, éthique. Et dans cette transformation silencieuse, mais déterminante, la France avance ses pions avec une rare lucidité.