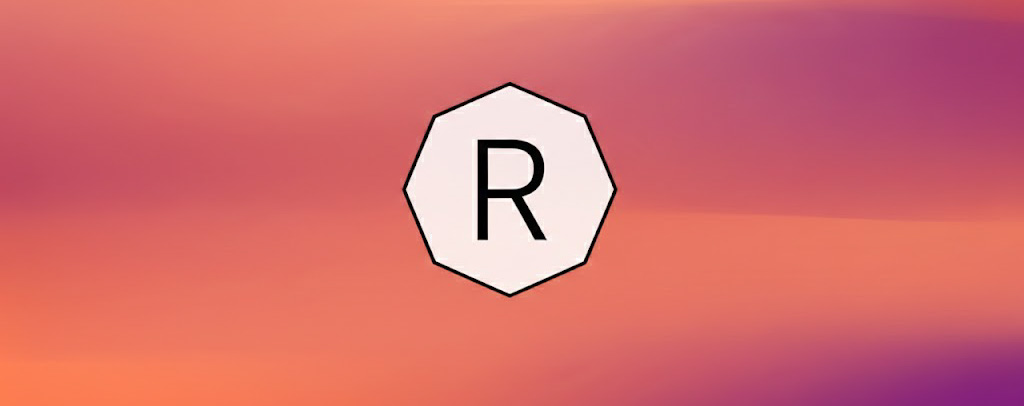Actuelle Présidente du SP2C (Syndicat Professionnel des Centres de Contact) depuis juillet 2022, Caroline Adam poursuit avec détermination son second mandat à la tête de cette organisation représentative d’un secteur clé de l’économie française. Caroline Adam a su structurer une stratégie collective au service de la valorisation, de la professionnalisation et du rayonnement du secteur. Elle incarne une capacité d’influence reconnue, en lien étroit avec les instances politiques, économiques et sociales. Lobbyiste avertie, elle porte auprès des décideurs publics les priorités de la filière, tout en accompagnant ses membres dans les transformations structurelles et réglementaires du métier.
Dans cet entretien, elle revient sur le secteur, ses mutations, et le rôle de l’IA dans l’évolution des métiers.
Le SP2C, fédération stratégique
Le SP2C, Syndicat Professionnel des Centres de Contact, agit comme une véritable fédération sectorielle affiliée au MEDEF. Il regroupe près de 75 % du marché français de la relation client externalisée, soit neuf grandes entreprises couvrant l’ensemble des canaux d’interaction entre marques et usagers : téléphone, email, chat, réseaux sociaux ou courrier.
Derrière les marques grand public, ces acteurs majeurs du BPO (Business Process Outsourcing) opèrent dans l’ombre, tout en étant déterminants : 3,56 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus de 100 000 salariés en France. Une activité qui dépasse même l’aéronautique en volume d’emplois. « Les Français sont des champions mondiaux de la relation client », rappelle Caroline Adam, citant les leaders du secteur comme Téléperformance, Concentrix (ex-Webhelp) ou Foundever (ex-Sitel).
Une intégration progressive de l’IA
La digitalisation a transformé les usages depuis plus d’une décennie. L’IA, quant à elle, s’inscrit dans une continuité technologique, avec une accélération notable ces trois dernières années. L’approche reste pragmatique : pas de remplacement massif des humains, mais un renforcement des compétences et de la productivité.
Parmi les usages précurseurs, Caroline Adam cite l’IA prédictive, déployée pour anticiper les flux d’appels selon les pics d’activité (vacances, événements sportifs, annonces gouvernementales), l’absentéisme ou la saisonnalité. L’objectif : optimiser la mobilisation des effectifs en temps réel.
Autre exemple emblématique : les « IA ergonomes ». Autrefois, un ergonome humain observait les gestes des agents, les clics, les ouvertures de pages, pour recommander des améliorations. Aujourd’hui, l’IA analyse des milliers de sessions et propose des scénarios d’optimisation validés ensuite par les responsables informatiques. Cette forme d’ergonomie algorithmique préfigure une hybridation des métiers.
L’IA au service de l’émotion et de la sémantique
Dans les situations de stress ou d’urgence, comme pendant la crise sanitaire, des vocal bots alimentés par IA ont répondu automatiquement aux questions simples (vaccination, horaires, centre le plus proche). Ils ont réorienté vers un agent humain les appels détectés comme anxieux par l’analyse du ton et du timbre.
Côté analyse sémantique, les cas d’usage concernent le décryptage de verbatims clients à grande échelle. Exemple frappant : dans les services de livraison, si 80 % des réclamations mentionnent des retards, ce n’est pas toujours ce qui génère l’insatisfaction majeure. C’est plutôt la nature du produit et le moment émotionnel (elle cite l’exemple de la robe de mariée livrée en retard ou non conforme) qui cristallisent les frictions clients. L’IA permet ici une priorisation fine des actions correctives.
De nouveaux métiers grâce à l’IA générative
Les usages de l’IA générative se multiplient. Côté traduction, ils permettent de maintenir une qualité de service 24/7 pour des clientèles internationales exigentes, comme chez BlueLink, qui gère des marques de luxe. L’IA traduit les requêtes clients, permettant à un agent francophone de répondre en néerlandais ou japonais via email.
Dans la formation, l’IA joue un double rôle : elle apprend des conseillers humains (« coach the bot ») et sert d’entraineur virtuel pour les nouveaux arrivants. Elle simule des cas clients, propose des corrections, et suit les performances. L’ancien modèle de supervision — écouter 10 appels par mois — est remplacé par une analyse automatisée de 100 % des interactions. Le plan de formation est ainsi personnalisé avec une grande précision.
Autre exemple : dans l’assurance, lors d’un sinistre, l’IA retranscrit automatiquement les échanges, enrichit le CRM, suggère des questions pertinentes et planifie le rendez-vous avec l’expert. Elle permet à l’agent de se concentrer sur l’émotionnel et la relation humaine.
Agents IA et expérience agent : une nouvelle frontière
Alors que les agents conversationnels se multiplient, la question de leur intégration dans les parcours digitaux se pose. Caroline Adam insiste sur la nécessité d’une compatibilité entre l’agent IA et l’interface numérique du service ciblé. « Si le site de l’agence de voyages par exemple n’est pas conçu pour coopérer avec un agent IA, la réservation échouera ».
Mais au-delà du cas d’usage B2C, elle alerte sur les implications éthiques et stratégiques, de l’automatisation des processus de négociation B2B. Remplacer les acheteurs humains par des agents IA paramétrés pour négocier dans une fourchette prédéfinie pourrait à terme conduire à des compromis réducteurs, gommant la vision à long terme ou les subtilités relationnelles. L’IA serait alors un outil trop « littéral » pour un enjeu aussi contextuel et humain que la négociation complexe.
RPA, open banking et cas extrêmes d’automatisation
Certaines innovations associent IA et automatisation (Robotic Process Automation). Dans le e-commerce, des RPA nourries à l’IA consultent en temps réel les différentes plateformes logistiques pour informer un client sur le statut d’une commande multiproduit.
Autre cas spectaculaire : Smart Push, une startup française qui permet, avec l’accord de l’usager, de s’ assurer en temps réel de la véracité d’un dossier de crédit via les données bancaires ouvertes (open banking). Ce gain de temps réduit drastiquement la fraude documentaire.
Une acculturation progressive, une vision systémique
Le SP2C aide ses membres à structurer une acculturation pragmatique à l’IA. Le conseil : partir du parcours client, identifier les irritants, tester en POC, et ne pas céder à l’effet de mode. « Ce n’est pas parce qu’on fait de l’IA que c’est utile. L’essentiel est de mesurer le ROI et d’apporter une vraie valeur d’usage ».
Cette méthode test-and-learn permet aussi de limiter les échecs : « 80 % des POC lancés par les grandes entreprises ont échoué » rappelle-t-elle.
Des impacts RH maîtrisés et des nouveaux rôles
Les gains de productivité observés (15 à 30 %) ne se traduisent pas en licenciements, mais en moindres recrutements. Certains profils émergent, sans formation d’ingénieur : les « data stewards », ou gestionnaires de bases de données, qui assurent la qualité des informations alimentant les IA.
Un conseiller client aguerri peut évoluer vers ces métiers de la donnée. L’enjeu est de maintenir l’employabilité dans un secteur connu pour son turnover, tout en montant en gamme.
Vers une éthique industrielle de l’IA ?
Face aux risques de déshumanisation ou d’hallucinations algorithmiques (par exemple un chatbot qui insulte sa propre entreprise ou propose des tarifs absurdes), la réflexion éthique s’impose.
La Poste a déjà publié une charte d’usage responsable de l’IA, intégrant ses prestataires. Pour l’heure, ses membres se conforment aux chartes des marques et aux réglementations européennes (IA Act, DORA, NIS2).
Une vision systémique et humaine
Enfin, Caroline Adam rappelle le principe de symétrie des attentions : améliorer l’expérience client suppose aussi de soigner celle des collaborateurs. L’IA doit servir à décharger les agents des tâches pénibles pour les recentrer sur l’écoute, l’empathie, la personnalisation.
« L’IA n’est pas une fin en soi. C’est un levier, à utiliser avec rigueur, éthique et stratégie », conclut-elle. Une parole incarnée, lucide et exigeante, pour un secteur qui conjugue technologie, utilité publique et compétences humaines.