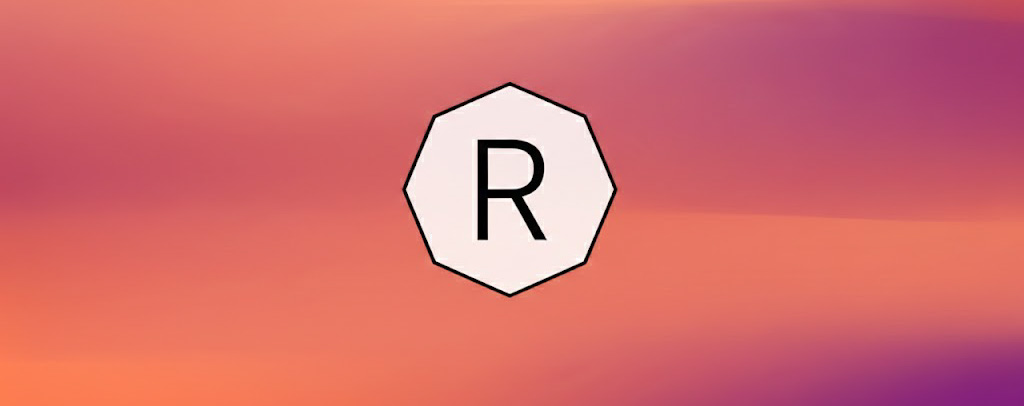Un regard économique sans filtre
Un regard économique sans filtre
Propos recueillis par Pascale Caron
Organisée par le Monaco Economic Board en partenariat avec Jutheau Husson, la conférence de Jean-Pierre Petit a proposé une lecture tranchée de la géopolitique contemporaine. Président des Cahiers Verts de l’Économie, ancien chef économiste chez Exane BNP Paribas, il défend une pensée libre, fondée sur l’analyse des rapports de force et non sur les normes idéologiques.
Il ne s’agit pas ici de commenter les intentions, mais d’observer les dynamiques. Le retour de Donald Trump au pouvoir n’est pas une anomalie, selon lui. C’est le signe d’un changement d’époque. La politique redevient brutale. Les États-nations reprennent la main. L’ère du multilatéralisme comme horizon de paix est révolue.
Un président qui agit, un monde qui se réorganise
Donald Trump gouverne par confrontation. Il ne dissimule pas ses priorités : souveraineté intérieure, rapports de force extérieurs. À Washington, il conteste l’indépendance d’agences fédérales jugées trop puissantes. Il marginalise les contre-pouvoirs technocratiques. À l’international, il assume une vision transactionnelle : les alliances ne sont plus idéologiques mais ponctuelles, contractuelles, bilatérales.
Jean-Pierre Petit insiste : il ne s’agit pas d’un repli. C’est une stratégie. Ce que Trump remet en cause, ce n’est pas la mondialisation, mais sa logique asymétrique. Il veut redéfinir les termes du commerce, contrôler les flux industriels, piloter les chaînes de valeur. Il utilise le dollar, la fiscalité, la menace douanière comme outils de puissance. Et il obtient des résultats.
L’Europe piégée par son impuissance structurelle
Face à cela, l’Europe se montre incapable de formuler une réponse cohérente. Elle se perd dans des injonctions contradictoires. Elle multiplie les normes mais perd en souveraineté réelle. Elle parle de transition énergétique mais importe du gaz de schiste américain. Elle prône la justice sociale mais dépend des flux chinois. Elle proclame l’autonomie stratégique mais achète ses armes aux États-Unis.
Jean-Pierre Petit revient longuement sur l’épisode emblématique de la rencontre entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Un « accord » signé en Écosse, dans l’urgence, sans contenu tangible, sans levier de négociation. L’Europe a cédé sans obtenir. Elle a subi sans répliquer. Elle a financé sans contrepartie.
Une vision économique de la monnaie
La politique monétaire est un autre révélateur. En 2019 déjà, Trump avait contraint la Fed à assouplir sa position. En 2025, il réaffirme que la souveraineté industrielle passe par un contrôle du coût du capital. La croissance et l’emploi doivent primer sur la lutte contre une inflation devenue secondaire. La banque centrale devient un outil politique.
En Europe, la situation est inverse. La BCE, attachée à sa doctrine, tarde à réagir. Elle privilégie les équilibres budgétaires à court terme. Elle freine l’investissement productif. Elle accepte des taux réels élevés dans un contexte de faible croissance. Résultat : le fossé se creuse.
Désindustrialisation accélérée
Pour Jean-Pierre Petit, le cœur du problème européen est productif. L’Europe a démantelé ses outils industriels. Elle ne fabrique plus ses infrastructures critiques. Elle dépend de ses concurrents pour les composants, les machines, les plateformes technologiques. Le libre-échange, sans stratégie, a vidé les territoires.
Les États-Unis, au contraire, relocalisent. Ils investissent massivement. Ils subventionnent les industries clés. Ils protègent leurs marchés. Ils sécurisent leurs ressources. La loi Inflation Reduction Act (IRA) en est un exemple : un plan cohérent de reconquête industrielle. L’Europe n’a pas d’équivalent. Elle régule. Elle interdit. Elle compense. Mais elle ne produit plus.
La technologie comme levier de souveraineté
La souveraineté technologique devient, selon Petit, la ligne de fracture décisive du XXIe siècle. L’Europe a pris un retard considérable. Les semi-conducteurs sont asiatiques. Le cloud est américain. L’intelligence artificielle dépend des modèles étrangers. Les infrastructures critiques sont sous contrôle externe.
Les États-Unis, la Chine, Israël, la Corée du Sud ont compris que la domination technologique conditionne la souveraineté politique. Ils forment, financent, protègent leurs filières. L’Europe, elle, applique des régulations avant même d’avoir bâti des acteurs capables de rivaliser. Résultat : des entreprises fragiles, des pertes de savoir-faire, des projets dépendants.
Le facteur humain au cœur du déclin
Le constat est d’autant plus sévère que l’Europe affaiblit aussi son capital humain. Jean-Pierre Petit évoque la France avec une gravité particulière. Système éducatif en déclin. Réformes sans résultats. Endettement incontrôlé. Déficit structurel. Productivité en recul. Marché du travail désincitatif. Système de formation obsolète.
La France, dit-il, est en état de dette humaine autant que de dette financière. Le pays souffre d’une perte d’autorité, d’une perte de compétence, d’une perte d’espoir. Le personnel politique est instable. Les institutions sont contestées. L’économie est sous respiration artificielle. L’administration s’est substituée à la stratégie.
L’ordre international n’est plus normatif
La séquence ukrainienne, comme la situation en Iran, confirment ce changement de logiciel. Le droit international est marginalisé. Les organisations multilatérales sont impuissantes. L’ONU ne pèse plus. L’OMC est contournée. L’OTAN est déséquilibrée. Ce qui compte désormais, c’est la capacité à dissuader, à négocier sous tension, à frapper vite.
Trump ne cherche pas à imposer un modèle. Il veut préserver un avantage. Il ne s’embarrasse pas de promesses. Il signe des deals. Il désamorce ou accentue la pression selon l’intérêt du moment. Il ne fait pas de morale. Il agit. Il désoriente parce qu’il ne joue pas selon les règles établies. Mais il impose ses priorités.
Vers une géoéconomie brutale
Cette mutation du monde est visible aussi sur les marchés. L’or monte, non pas en raison des taux, mais comme signe de défiance vis-à-vis des institutions. Les banques centrales elles-mêmes achètent de l’or. Les devises sont contestées. Les dettes deviennent insoutenables. La valeur refuge redevient matérielle.
Le monde redevient géoéconomique. Ce ne sont plus les accords, mais les actifs qui comptent. Ce ne sont plus les traités, mais les ressources. Ce ne sont plus les discours, mais les usines. La logique de puissance ne se cache plus. Elle s’impose.
Une fatigue historique de l’Europe
Jean-Pierre Petit termine sur un point crucial : la question des élites. Il cite Pareto. Quand une société n’assure plus le renouvellement qualitatif de ses élites, elle entre en déclin. L’Europe est dans cette impasse. Ses dirigeants ne produisent plus de stratégie. Ses systèmes de sélection sont épuisés. L’administration prime sur la compétence. Le conformisme bloque l’innovation.
La brutalité du monde à venir exigera des élites capables de trancher, de décider, de construire. Sans cela, l’Europe restera spectatrice. Le confort des normes ne suffit plus. Le monde demande de la force. Et de la vision.
Conclusion : produire de la puissance ou sortir du jeu
Ce que démontre Jean-Pierre Petit dans cette conférence, c’est la nécessité de penser la puissance comme une production, non comme un droit. Elle ne découle pas des institutions. Elle repose sur la maîtrise des leviers économiques, industriels, technologiques, humains.
Face à un monde instable, régi par les rapports de force, l’Europe doit choisir. Soit elle accepte sa marginalisation, soit elle reprend le chemin de la stratégie. Cela suppose de rompre avec l’illusion du droit sans moyens, et de reconstruire une capacité d’action. La puissance n’est plus un héritage. Elle devient une décision.