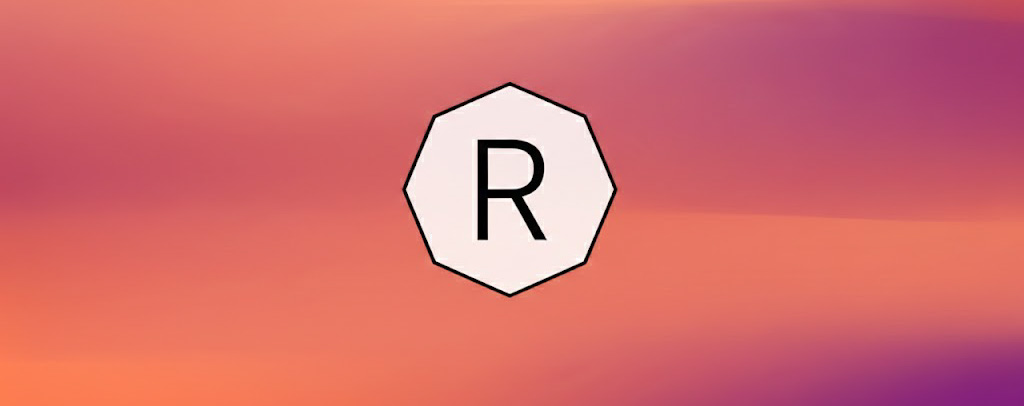1er Forum du Patronat Francophone au Sénat : quand l’intelligence artificielle rencontre le défi climatique
Paris, Sénat — Dans l’hémicycle du Palais du Luxembourg, le Groupement du Patronat Francophone (GPF) a lancé son premier Forum « Solutions numériques pour le climat ». Ce rendez-vous, inédit par son envergure et son ambition, a réuni décideurs politiques, diplomates, entrepreneurs et experts pour débattre d’une équation complexe : comment concilier transition écologique et transformation numérique dans l’espace francophone ?
Le lieu n’était pas anodin : le Sénat, institution au cœur de la vie démocratique française, offrait un cadre solennel à une réflexion qui dépasse largement les frontières hexagonales.
Des discours d’ouverture marqués par l’engagement
C’est Patrick Baruel, président de la commission Climat et RSE du GPF, qui a eu l’honneur d’ouvrir les travaux. D’une voix assurée, il a insisté sur le rôle du patronat francophone dans la transformation écologique :
« Nous devons dépasser le stade des intentions pour passer à l’action. Ce forum doit être un lieu d’engagement concret. Les entreprises francophones, par leur diversité et leur capacité d’innovation, ont un rôle déterminant à jouer. »
La parole a ensuite été donnée à Bestine Kazadi, Ministre de la Francophonie de la République Démocratique du Congo. Elle a rappelé le poids stratégique de l’Afrique dans cette équation, en soulignant à la fois la richesse des ressources naturelles du continent et la nécessité d’une gouvernance internationale équitable.
« L’Afrique est au centre des enjeux climatiques et numériques. Nos ressources, notre jeunesse et nos savoir-faire doivent être pleinement intégrés dans la construction d’un numérique durable et d’une transition juste. La francophonie est le cadre naturel de cette coopération. »
Enfin, Jean-Loup Blachier, président du GPF, a replacé l’événement dans une perspective plus large : celle de la puissance économique francophone. Pour lui, la francophonie constitue un levier majeur de coopération et de compétitivité face aux blocs américain et chinois :
« La francophonie, c’est un marché de plus de 320 millions de personnes. C’est une communauté d’intérêts et de valeurs. Si nous savons mettre en commun nos compétences, nos talents et nos innovations, nous pouvons créer un modèle alternatif au service de la planète. »
Table ronde 1 : IA et environnement, regards croisés
La première table ronde, animée par Stéphane Tiki, directeur du développement et porte-parole du GPF, avait pour thème : « L’intelligence artificielle au service de l’environnement : une approche francophone pour la gestion durable des ressources ».
Cinq experts sont venus confronter leurs visions : Florent Bouguin (Optel, Canada), Juliette Duquesne (journaliste), Jean-Marc Le Pevédic (Calcool Studio), Emmanuelle Prono (The Advisory) et Georges Phinorson (entrepreneur).
Florent Bouguin : la traçabilité comme levier de compétitivité durable
Premier à intervenir, Florent Bouguin a défendu la nécessité d’une transparence accrue des chaînes d’approvisionnement pour réduire l’impact environnemental des entreprises.
« Grâce à la traçabilité, nous pouvons mesurer l’empreinte carbone des chaînes logistiques, identifier les émissions liées à la déforestation, suivre la biodiversité grâce aux images satellites. Mais au-delà des chiffres, c’est aussi une question de droits humains : on ne peut pas séparer justice sociale et urgence climatique. »
Selon lui, la durabilité ne peut être dissociée de la compétitivité : moderniser les chaînes de valeur, c’est aussi sécuriser leur performance économique.
Un numérique trop gourmand en ressources
Journaliste spécialisée et autrice de L’humain au risque de l’intelligence artificielle, Juliette Duquesne a dressé un constat sévère :
« Le numérique représente déjà 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Nous atteindrons probablement 5 % en 2025. Et ce n’est pas seulement une question de CO₂ : l’extraction des métaux rares nécessaires à ces technologies va atteindre ses limites. »
Elle a mis en garde contre une vision naïve de la transition numérique :
« Il faut un autre numérique, certes, mais aussi moins de numérique. Les capteurs, les data centers, les équipements pèsent lourdement sur l’environnement. 60 % de la pollution numérique vient de la fabrication des équipements. »
Pour elle, seules des solutions locales, comme la réutilisation de serveurs pour chauffer l’eau d’immeubles, offrent une voie crédible.
L’innovation territoriale par l’upcycling
Jean-Marc Le Pevédic, président de Calcool Studio, a poursuivi dans la même logique de sobriété. Son entreprise travaille avec des serveurs de seconde vie et développe des technologies d’upcycling.
« Notre objectif est de donner une seconde vie aux infrastructures numériques, d’optimiser le refroidissement et de recycler la chaleur produite par les data centers. Nous travaillons avec les acteurs locaux, les bailleurs sociaux, pour créer des synergies concrètes sur le terrain. »
Pour lui, l’avenir se joue dans les territoires : adapter l’IA aux besoins locaux plutôt que de multiplier les infrastructures géantes.
L’économie circulaire amplifiée par l’IA
Senior Advisor chez The Advisory, Emmanuelle Prono a élargi le débat à la gestion des ressources naturelles. Elle voit dans l’IA un outil capable d’optimiser réseaux énergétiques, gestion de l’eau et flux industriels.
« L’intelligence artificielle peut anticiper les besoins en eau, prévenir les pénuries, intégrer les surplus d’énergies renouvelables dans les réseaux. Elle peut faciliter la conception de produits bas carbone et circulaires. »
Elle a cité une étude de la Fondation Ellen MacArthur estimant à 90 milliards de dollars par an le potentiel économique de l’économie circulaire électronique, accélérée par l’IA.
La souveraineté francophone comme horizon stratégique
Enfin, Georges Phinorson a replacé le débat dans une perspective géopolitique. Pour lui, l’IA ne peut être envisagée uniquement sous l’angle écologique :
« L’intelligence artificielle est encore un enfant qui apprend à marcher. Mais si nous continuons à dépendre des clouds étrangers, des puces Nvidia et des modèles américains, nous serons condamnés à subir. »
Il appelle à bâtir un écosystème francophone souverain, s’appuyant sur Mistral pour les modèles de langage et OVH pour le cloud, afin d’éviter la dépendance aux géants étrangers.
Entre urgence écologique et souveraineté stratégique
Les échanges ont fait émerger une ligne de fracture féconde.
- Pour Florent Bouguin et Juliette Duquesne, la priorité absolue est l’urgence climatique, qui exige sobriété, régulation et transparence immédiates.
- Pour Georges Phinorson, l’enjeu central est la souveraineté numérique, condition de toute autonomie politique et économique à long terme.
Ces deux approches ne s’opposent pas totalement, mais elles révèlent une tension fondamentale. Agir vite pour réduire l’impact environnemental du numérique, tout en préparant l’avenir stratégique de la francophonie dans un monde dominé par les États-Unis et la Chine.
Une francophonie économique en construction
Ce premier forum du GPF au Sénat a posé les jalons d’un débat structurant pour la francophonie économique. Tous les intervenants se sont accordés sur un point : avec ses 320 millions de locuteurs, ses savoir-faire et ses ressources, l’espace francophone dispose d’un potentiel unique pour inventer un modèle alternatif, conciliant innovation numérique et transition écologique.
Reste à transformer ces échanges en politiques concrètes et en partenariats tangibles. Car comme l’a résumé Florent Bouguin dans ses mots de conclusion :
« Le climat n’attend pas. L’urgence, c’est d’agir maintenant. La francophonie doit trouver non pas comment copier les autres, mais comment inventer ce qui n’existe pas encore. »