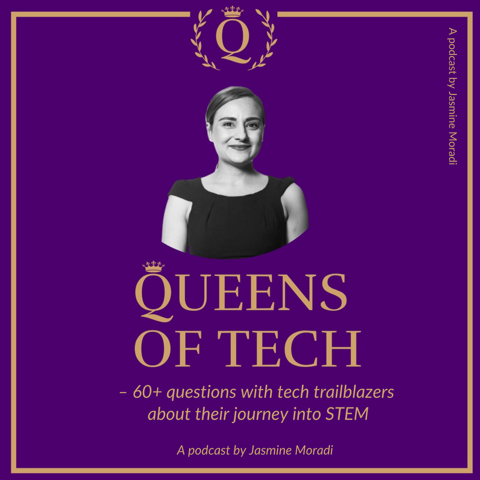Propos recueillis par Pascale Caron
Monaco, 2 avril 2025. C’est à la Maison de France, au cœur de Monaco, que les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE) ont organisé une table ronde sur le thème du « Luxe à la française ». Pour l’occasion le lieu était décoré par les œuvres de Laurence Jenkell et Marcos Marin.
La conférence inaugurale était à haute valeur symbolique et stratégique, réunissant des figures emblématiques de l’écosystème du luxe. Bénédicte Épinay, présidente du Comité Colbert, Luc Lesénécal, président de l’Institut pour les savoir-faire français, Jean d’Haussonville, ambassadeur de France à Monaco, et Sylvie Tarbouriech, vice-présidente Global Image du groupe Air France. Cette table ronde etait animée par Sophie Arnaud Deromedi, membre du Bureau exécutif des CCEs, et Présidente d’Adstoria.
Tous ont partagé une conviction : le luxe à la française est bien plus qu’un marché. C’est un patrimoine, une culture, un levier économique stratégique, et une responsabilité partagée.
Le Comité Colbert, colonne vertébrale du luxe français
La première à prendre la parole est Bénédicte Épinay, à la tête du Comité Colbert, cette alliance fondée en 1954 par Jean-Jacques Guerlain. Elle rappelle que dès l’origine, le luxe français s’est structuré autour d’une idée novatrice : agir ensemble, chasser en meute, unir des maisons pourtant concurrentes pour promouvoir un art de vivre unique.
Aujourd’hui, le Comité Colbert rassemble 96 maisons, 17 institutions culturelles et six membres européens. Mais ce qui les unit, ce n’est pas qu’une ambition commerciale. C’est un socle commun : la défense des métiers d’art, l’excellence artisanale, et la transmission patiente d’un savoir-faire ancré dans l’histoire.
« Nos liens avec des institutions comme l’Opéra de Paris ou le Château de Versailles sont évidents : elles aussi préservent des métiers rares. Ce qui nous unit, c’est la culture, la création, et le rêve. »
Une histoire longue, un présent collectif, un avenir à construire
Elle resitue le luxe français dans une perspective historique : des joyaux de la Couronne instaurés par François Ier aux expositions universelles du XIXe siècle, en passant par Colbert, qui structura l’économie française autour des manufactures royales. Ces racines sont profondes, mais ne valent que si elles nourrissent le présent.
C’est ainsi que des géants comme Chanel, Hermès ou Dior continuent, 70 ans après la création du Comité, à s’engager collectivement. « Ils ont compris qu’ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu’eux. Aucun ne peut incarner seul le luxe à la française. C’est ensemble que cette identité prend forme. »
L’urgence : la transmission des métiers d’art
Mais cette excellence est aujourd’hui menacée. La France fait face à une pénurie critique d’artisans. « Il manque 20 000 mains dans nos maisons », alerte Épinay. Dans l’artisanat au sens large, ce chiffre monte à 50 000. Une situation paradoxale dans un pays où le luxe est une vitrine mondiale. La cause est bien connue : la dévalorisation des métiers manuels. « Le CAP est encore vu comme une voie de relégation. Je rencontre des parents affolés à l’idée que leur enfant veuille devenir joaillier ou couturier. » Pour inverser la tendance, le Comité Colbert multiplie les initiatives. Participation aux Journées européennes des métiers d’art, collaboration avec le musée d’Orsay, et surtout l’événement « Les Deux Mains du Luxe », organisé du 2 au 5 octobre au Grand Palais. Une exposition immersive, gratuite et ouverte à tous, pour donner envie aux jeunes — et aux adultes en reconversion — de rejoindre ces métiers d’exception.
Une industrie profondément ancrée dans les territoires
Luc Lesénécal, président de l’Institut pour les savoir-faire français, et par ailleurs CEO des Tricots Saint James, poursuit : « Nous avons en France 188 territoires de savoir-faire. Un maillage exceptionnel, mais fragile. » Lui aussi insiste sur l’urgence à recruter, transmettre et valoriser les métiers de la main. « Nous ne serons jamais compétitifs par le prix. Mais par la qualité, oui. Et la qualité, c’est le fruit de la main. » Il dévoile les résultats de l’étude « Les Éclaireurs », menée pendant deux ans avec un comité scientifique. Chiffres à l’appui : les métiers d’art en France génèrent un chiffre d’affaires supérieur à celui de l’industrie pharmaceutique. « C’est énorme. Et pourtant, nous manquons encore de reconnaissance. »
C’est dans ce contexte que les CCE, ont pris un engagement fort. Une convention va être signée pour que chaque conseiller, en France ou à l’étranger, parraine un artisan, un métier d’art ou une entreprise du patrimoine vivant. « Nous allons ouvrir des marchés, créer des ponts, offrir du mentorat. C’est une mobilisation nationale et internationale. » Les CCE accompagneront aussi des délégations régionales à l’Exposition universelle d’Osaka en 2025, avec un objectif : donner une visibilité mondiale aux savoir-faire français.
Un rayonnement culturel fondé sur le dialogue
En matière d’international, l’un des projets les plus inspirants présentés est celui des « Conversations de savoir-faire », organisées en Chine en 2024 à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises. À l’initiative de l’ambassadeur de France à Pékin, artisans français et chinois ont partagé techniques, gestes, outils — et différences culturelles.
Un moment d’émotion, mais aussi une démonstration de diplomatie culturelle active. « Nous ne sommes pas une industrie banale. Nous sommes une industrie culturelle. » C’est pourquoi le Comité Colbert s’engage à l’international non seulement pour promouvoir, mais aussi pour comprendre, dialoguer, tisser des liens.
Les batailles réglementaires à Bruxelles
Ce prestige n’épargne pas l’industrie du luxe d’un autre combat, plus technique : la régulation européenne. Bénédicte Épinay ne mâche pas ses mots : « Nous sommes confrontés à une avalanche de régulations. 152 textes en deux ans dans le cadre du Green Deal. »
Certaines sont porteuses de progrès. D’autres, d’absurdités. Exemple frappant : le projet de n’autoriser que dix formes de bouteilles pour les parfums, dans une optique de standardisation. « Mais que fait-on de la propriété intellectuelle ? De l’identité des marques ? » Autre aberration : assimiler le recyclage des invendus à leur destruction, au mépris des efforts de durabilité déployés par les maisons. « Le danger, c’est que le luxe devienne un gros mot, que l’exception culturelle soit ignorée. Nous ne sommes pas H & M. Nous devons être considérés comme un cas à part. »
Le Comité Colbert, porte cette voix à Bruxelles. Une voix de vigilance, de pédagogie, et de diplomatie économique.
Air France : transporter l’élégance française
Pour Sylvie Tarbouriech, vice-présidente Global Image du groupe Air France, le luxe à la française s’incarne aussi dans le voyage. « Depuis 1933, Air France est une vitrine du meilleur de la France. Et la Première classe en est la quintessence. »
La compagnie a su faire du ciel une extension de l’art de vivre. Uniformes dessinés par des couturiers, vaisselle signée Bernardaud, champagne dans toutes les classes… « Nous avons une mission : offrir une expérience globale du luxe, alliant savoir-faire, relation, et élégance. » Le mot-clé ? Personnalisation. « Un bon service, c’est savoir quand parler, et quand se taire. C’est l’art de la juste distance. »
Une définition plurielle, mais une ambition commune
En fin de conférence, chacun est invité à définir ce que représente, pour lui, le « luxe à la française ». Les réponses, variées, forment un paysage cohérent : ancrage dans l’histoire, excellence des gestes, transmission des savoirs, goût du détail, mais aussi audace créative et capacité à faire rêver.
Jean d’Haussonville, ambassadeur de France à Monaco, conclut avec justesse : « Le luxe, étymologiquement, vient de lux : la lumière. Il éclaire, il crée, il transcende. » Pour lui, le luxe à la française est comme un jardin à la française : géométrique, rigoureux, mais ouvert à l’émotion, à la nature, à l’imprévu. Un subtil équilibre entre raison et rêve, héritage et désir.
Et si, comme le disait Jean-Louis Dumas, le luxe était ce désir qui l’emporte sur la raison ? Dans une époque marquée par les tensions géopolitiques, les enjeux climatiques, et les défis de transmission, le luxe à la française demeure une ressource rare, précieuse… et inspirante.