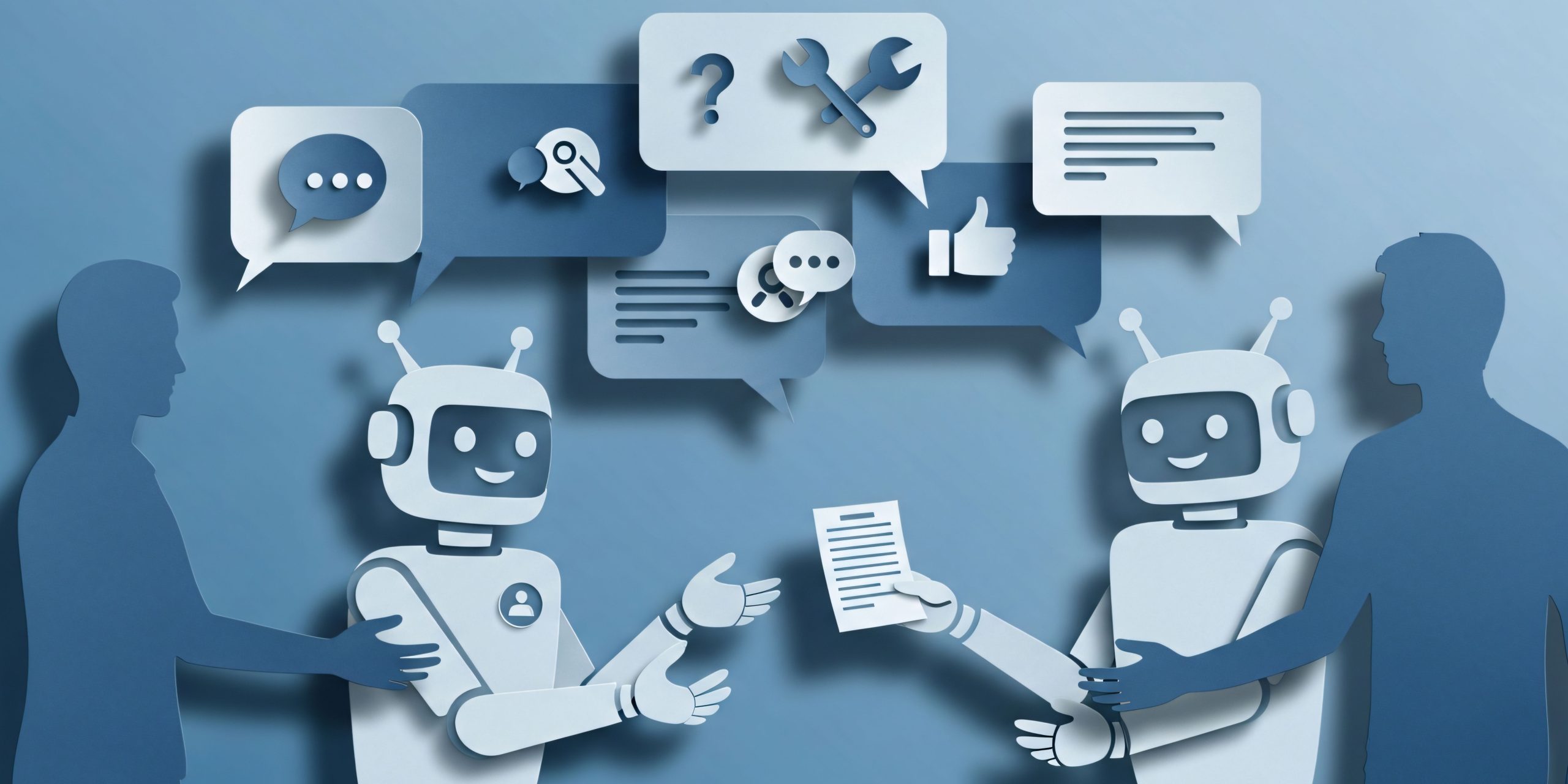Le 2 avril 2025, à l’hôtel Westminster de Nice, dans le cadre des rencontres de l’ISCAE, le philosophe Raphaël Enthoven a livré une conférence dense, stimulante, et subtilement provocatrice autour d’un thème d’apparence simple : « L’intelligence artificielle est-elle un oxymore ou un pléonasme ? » La question, volontairement paradoxale, ouvre sur une réflexion plus profonde : que signifie « intelligence », et dans quelle mesure peut-elle être artificielle ? En convoquant la tradition philosophique — d’Aristote à Kant, de Jankélévitch à Nietzsche — il invite son auditoire à penser autrement l’IA, non pas comme une menace ou une promesse, mais comme un révélateur de nos limites, de nos peurs, et de nos illusions.
Le 2 avril 2025, à l’hôtel Westminster de Nice, dans le cadre des rencontres de l’ISCAE, le philosophe Raphaël Enthoven a livré une conférence dense, stimulante, et subtilement provocatrice autour d’un thème d’apparence simple : « L’intelligence artificielle est-elle un oxymore ou un pléonasme ? » La question, volontairement paradoxale, ouvre sur une réflexion plus profonde : que signifie « intelligence », et dans quelle mesure peut-elle être artificielle ? En convoquant la tradition philosophique — d’Aristote à Kant, de Jankélévitch à Nietzsche — il invite son auditoire à penser autrement l’IA, non pas comme une menace ou une promesse, mais comme un révélateur de nos limites, de nos peurs, et de nos illusions.
Ce n’est pas une conférence sur la technologie au sens strict, mais une méditation sur l’humain, sur ce qui le rend irréductible à la machine. Enthoven interroge non seulement la capacité de l’intelligence artificielle à penser, mais aussi la manière dont cette croyance révèle notre propre difficulté à cerner l’essence de la pensée. La question n’est pas tant : que peut faire l’IA ? Mais : que sommes-nous en train de devenir à force de nous comparer à elle ?
Définir l’intelligence : entre faculté technique et profondeur humaine
Dès les premières minutes de son intervention, Raphaël Enthoven propose une alternative féconde : considérer l’expression « intelligence artificielle » comme un pléonasme ou un oxymore. Tout dépend, explique-t-il, de ce que l’on entend par « intelligence ».
Si l’on se réfère à une définition fonctionnelle — la capacité de classer, analyser, synthétiser — alors, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un artefact soit dit « intelligent ». En ce sens, l’intelligence artificielle n’est qu’une extension logique de notre propre faculté de traitement de l’information. Le terme est donc superflu. Un pléonasme.
Mais si l’on entend par « intelligence » quelque chose de plus profond — la complicité entre deux êtres, l’intelligence du cœur, cette forme d’attention subtile qui échappe à toute algorithmisation — alors l’expression devient contradictoire. L’intelligence, ainsi conçue, ne saurait être artificielle. Elle est incarnée, émotionnelle, intuitive, imprévisible. Elle suppose un esprit, c’est-à-dire une part d’irréductible. En ce sens, « intelligence artificielle » est un oxymore.
Il ne cherche pas à trancher entre ces deux lectures. Il propose au contraire de les faire vivre ensemble, de faire de cette tension le point de départ d’une réflexion critique. Car c’est précisément dans cet entre-deux, dans cette ambivalence constitutive, que se loge une pensée féconde. L’IA n’est pas seulement une prouesse technique ; elle est aussi une mise à l’épreuve de notre définition de l’humain.
Il reprend ici les arguments développés dans son dernier ouvrage, Le temps gagné, où il définit l’« esprit » comme ce que l’intelligence artificielle ne peut synthétiser. L’esprit n’est pas l’intelligence ; c’est sa limite. Ce n’est pas un déficit de calcul, mais une différence ontologique. Là où l’IA brille par sa puissance de traitement, l’esprit réside dans l’étonnement, dans la mémoire vivante, dans la simplicité non réductible.
L’enseignement de la philosophie : un territoire inhospitalier pour l’IA
L’une des démonstrations les plus frappantes de la conférence tient dans le lien établi entre intelligence artificielle et enseignement de la philosophie. Enthoven avance que l’IA et la philosophie relèvent de deux ordres radicalement différents. Pour le démontrer, il convoque trois notions clés : l’étonnement, la mémoire, et la simplicité.
L’étonnement
L’intelligence artificielle, observe Enthoven, repose sur un principe simple : ne pas être surpris par ce qu’on n’a pas encore vu. À l’image du mollusque Aplysie, étudié par les éthologues et évoqué par Yann LeCun dans « Quand la machine apprend », l’IA apprend par exposition répétée. Elle adapte ses réponses aux stimuli connus, jusqu’à prévoir des situations inédites. L’intelligence artificielle est prédictive, réactive, ajustée.
Or la philosophie commence à l’exact opposé. Depuis Aristote, elle naît de l’étonnement. Mais pas l’étonnement devant l’extraordinaire ou l’inhabituel — Enthoven ironise ici en évoquant un homme nu chantant L’Internationale. Ce qui fonde la pensée, c’est la capacité à s’étonner de ce qui va de soi. De remettre en question l’évidence, l’habitude, le langage commun. Philosopher, c’est s’étonner de ce qu’on voit tous les jours sans plus le voir.
Ainsi, tandis que l’IA s’entraîne à ne pas être surprise, la philosophie s’évertue à ne jamais cesser de s’étonner. L’orientation est inverse. L’une cherche à réduire l’inconnu, l’autre à rouvrir le connu.
La mémoire
Deuxième point : la mémoire. L’expérience que nous faisons de notre propre mémoire — surtout la veille d’un examen — est celle du manque, du doute, de la peur de ne plus rien savoir. Notre mémoire n’est ni exhaustive ni panoramique. Elle se dérobe précisément lorsqu’on voudrait qu’elle se déploie.
La mémoire humaine est lacunaire, émotionnelle, imprévisible. Elle ne stocke pas l’information comme un disque dur, elle la réactualise dans l’action. Elle est un art du surgissement, non de la conservation. Ce qui est en nous ne s’y trouve jamais comme dans un entrepôt. Elle est une présence sans lieu.
Là encore, l’écart avec la mémoire machinique est total. Une IA conserve, restitue, compile. Elle dispose d’un « conservatoire ». Le cerveau humain, lui, est un paradoxe : il conserve sans entrepôt, il sait sans savoir qu’il sait. C’est cette dynamique vivante qui fonde une différence radicale entre le vivant et le système.
La simplicité
Enfin, la simplicité. Contrairement aux idées reçues, Enthoven soutient que ce n’est pas la complexité qui échappe aux machines. Toute complexité est potentiellement modélisable. Ce qui résiste, c’est la simplicité. Cette part de l’humain qui ne s’explique pas.
Il donne l’exemple du sentiment du beau : face à un coucher de soleil, on dit « c’est beau », pas « je trouve cela beau ». Ce jugement s’impose avec la force d’une évidence universelle, sans être fondé sur un raisonnement. C’est un sentiment partagé, non conceptualisé.
De même pour l’amour : toute tentative d’en expliquer la cause le fait disparaître. « Je t’aime parce que… » est le début de la fin. L’amour est un élan sans pourquoi, une élection indivise. Ce qui compte, c’est la gratuité du sentiment, sa simplicité radicale.
Or cette simplicité-là — esthétique, éthique, existentielle — est précisément hors de portée de l’IA. Parce qu’elle ne repose pas sur des règles, mais sur une expérience vécue. Sur un irréductible. C’est cela, dit Enthoven, qui fait de la philosophie et de l’intelligence artificielle deux mondes étrangers l’un à l’autre.
L’irréductibilité de l’humain : traces, data et individus
Pour prolonger cette réflexion, Enthoven mobilise une distinction essentielle : celle entre les traces que nous laissons et ce que nous sommes.
L’un des mythes modernes du transhumanisme consiste à croire que l’on pourrait « reproduire » un individu à partir de l’ensemble de ses données : textes, photos, ADN, empreintes vocales, historiques numériques. L’épisode de la série Black Mirror qu’il évoque illustre ce fantasme : une femme, après la mort de son compagnon, commande un robot constitué de toutes ses datas. L’illusion tient jusqu’au moment où l’ersatz ne s’énerve pas, là où l’original l’aurait fait. Ce détail minime suffit à trahir l’imposture.
Pourquoi ? Parce que l’humain n’est pas la somme de ses traces. Parce que la cendre n’est pas le feu. Il manque à la machine ce que Jankélévitch appelle « le je-ne-sais-quoi » : ce principe d’individuation non formalisable, cette présence qui échappe à toute analyse.
Il rappelle que le mot « individu » signifie littéralement : « ce qui ne se divise pas ». L’individu est indivisible, il ne se laisse pas reconstituer à partir de morceaux. Frankenstein reste un mythe : on ne fait pas un vivant en assemblant des parties. Ce que nous sommes dépasse infiniment ce que nous laissons derrière nous.
La peur du remplacement : fantasme ancestral ou orgueil déguisé ?
La question de fond n’est donc pas « quand les machines vont-elles nous remplacer ? », mais « pourquoi avons-nous si peur qu’elles le fassent ? »
En mobilisant la méthode généalogique — héritée de Nietzsche et de Clément Rosset — Enthoven déplace la question. Il ne s’agit pas de savoir si une chose est vraie, mais d’interroger le besoin que nous ayons d’y croire. Pourquoi avons-nous besoin de penser que les machines sont sur le point de nous supplanter ?
Deux hypothèses sont avancées.
Première hypothèse : la fascination pour les écrans. Plus nous leur confions notre attention, plus nous projetons sur eux une forme de vie. Nous refusons d’admettre que notre propre passivité nous rend esclaves. Alors, nous prêtons aux machines des intentions malveillantes. Comme si l’on préférait croire à leur toute-puissance pour fuir notre propre responsabilité.
Deuxième hypothèse : un orgueil déguisé en modestie. Ceux qui annoncent que les machines vont nous dépasser se veulent modestes, mais se prennent, inconsciemment, pour Dieu. Reproduire l’humain, c’est imiter le Créateur. Fabriquer un être libre, c’est un acte divin. Le mythe du Golem, de Pinocchio, ou de l’androïde, est toujours le même : le moment où l’œuvre échappe à son auteur.
L’idée que la machine puisse devenir humaine est moins une peur qu’un fantasme de puissance. Une volonté d’autodivinisation.
Raphaël Enthoven ne se livre pas à une condamnation simpliste de l’IA. Il en reconnaît les puissances, les capacités, les promesses. Mais il en révèle aussi les limites. L’IA est un miroir. Elle ne nous dit pas seulement ce qu’elle est ; elle nous oblige à reconsidérer ce que nous sommes.
Ce que la machine ne peut atteindre — l’étonnement, la mémoire vive, l’amour, le sentiment esthétique — dessine en creux les contours de notre humanité. Ce n’est pas la puissance qui nous distingue, mais la fragilité, la spontanéité, la simplicité.
Aucune machine ne deviendra humaine. Mais l’humain, à force de tout vouloir calculer, pourrait bien devenir machine.