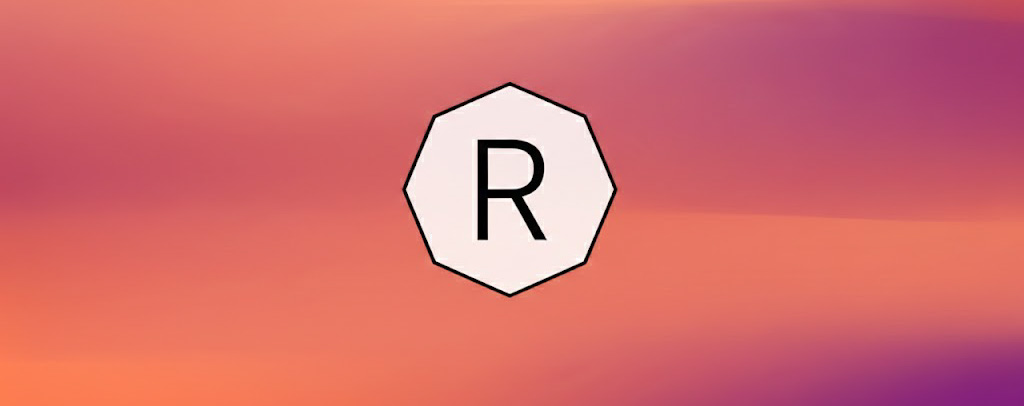Le 11 avril, le cinéma « Pathé Gare du Sud » à Nice a accueilli la soirée d’ouverture de la toute première édition du World AI Film Festival (WAIFF). Cet événement inédit était à la croisée du 7e art et de l’intelligence artificielle. En présence de nombreuses personnalités du monde du cinéma, cette soirée a marqué le lancement d’un rendez-vous international prometteur, où technologie et création se rencontrent.
Pour cet événement, un jury d’exception était réuni, présidé par le scénariste et réalisateur Thomas Bidegain. À ses côtés, des figures majeures du cinéma et de l’audiovisuel : Claude Lelouch (président d’honneur), Julie Gayet, Alexia Laroche-Joubert, Jean-David Blanc, Simon Bouisson, Anna Apter, Astou Sedy Diouf, Gilles Guerraz, Marianne Carpentier et Éric Libiot.
Trois temps forts pour une soirée inaugurale mémorable
• Un procès fictif de l’IA dans le cinéma, brillamment mis en scène, a ouvert le bal. Véritable moment de réflexion collective, il a interrogé la place de l’intelligence artificielle dans les processus de création artistique, entre innovation technologique et enjeux éthiques.
• Une sélection de films inédits, choisis parmi plus de 1 500 candidatures en provenance de 80 pays, a ensuite été projetée, témoignant de la diversité des formes et des imaginaires portés par cette nouvelle génération de cinéastes.
• La soirée s’est conclue par la remise des 11 prix officiels, récompensant des projets audacieux qui explorent les nouvelles écritures et narrations à l’ère de l’IA.
Un tribunal pour juger l’art : la fiction au service du débat public
Au lieu d’une projection classique ou d’un tapis rouge, c’est un procès fictif qui ouvre le bal. Une performance à mi-chemin entre théâtre judiciaire, satire sociale et réflexion sur le droit de création. Sur le banc des accusés : ECHO, un film (fictif) à succès entièrement généré par intelligence artificielle. Aucun acteur, aucun technicien, aucun tournage. Pourtant, 18 millions d’entrées en salle.
Peut-on encore parler de « cinéma » ? L’IA est-elle un outil ou un auteur ? À travers ce cas fictif, c’est tout un pan de l’avenir du 7e art qui est convoqué au tribunal de l’opinion.
L’idée du procès fictif est simple, mais puissante : mettre en scène une controverse réelle dans un format dramatique structuré, avec magistrats, avocats, témoins et plaidoiries. Le public joue le rôle du jury, sommé de réfléchir à une question centrale : une œuvre créée sans humains peut-elle prétendre au statut de film ? Et surtout, peut-elle être projetée dans les salles françaises, soumises à une législation exigeante en matière de production cinématographique ?
Deux chefs d’accusation sont retenus contre ECHO :
- Contournement des règles de production française, notamment les obligations liées au financement public, aux quotas de création nationale et à la présence de professionnels identifiés (réalisateurs, techniciens, acteurs).
- Dénaturation de la définition même d’un film, défini par le droit comme le fruit d’un travail collectif, d’un effort de création humaine encadré par des conventions culturelles et juridiques.
Sous des airs parodiques, l’exercice révèle de véritables tensions qui traversent aujourd’hui l’industrie cinématographique, de l’impact économique de l’IA à la question de la légitimité artistique.
Charlie Fabre : l’accusé qui revendique une révolution
C’est un monologue émouvant et rageur que livre Charlie Fabre, le réalisateur fictif d’ECHO, en ouverture du procès. Il ne se défend pas : il revendique. Marginalisé dans sa jeunesse, incapable de s’intégrer aux dynamiques de groupe dans les écoles de cinéma, il découvre en l’IA une partenaire de création absolue. « J’étais Dieu en jogging, seul sur le pont du navire, bravant les flots de l’imaginaire. »
Son plaidoyer est une ode à la démocratisation de l’art : « Avec l’IA, plus besoin d’être un Lelouch ou un Sédoux. Vous pouvez tous devenir des Charlie Fabre. »
Mais derrière l’humour, une colère sourde affleure : celle d’un créateur rejeté par les circuits traditionnels, qui trouve dans la technologie une revanche sociale et artistique. « Ce que vous entendez, c’est l’écho d’une humanité qu’on avait fini par oublier », affirme-t-il, dans un final aux accents prophétiques. Pour lui, ECHO ne trahit pas le cinéma. Il le libère de ses carcans. Il le rend à ceux que l’industrie avait exclus.
Le camp de l’accusation : une défense farouche du collectif
Face à cette vision romantique d’un cinéma libéré par la machine, la partie civile oppose une argumentation implacable, fondée sur le droit, la culture et l’éthique.
Me Latrappe, avocat du CNC, rappelle que ECHO, aussi spectaculaire soit-il, ne répond à aucun des critères requis, pour être projeté en salle en France. « Ce film n’a pas le droit d’exister, car il contourne toutes les obligations de production nationale. Il ne rémunère personne, ne cotise pas, ne participe à aucun écosystème. »
Le ton se durcit avec la procureure Bougrine, qui parle d’« un massacre silencieux » : « 300 000 intermittents du spectacle, supprimés en un clic. » Elle attaque frontalement : ECHO serait un produit froid, vide, dépourvu de chair, de doute, d’imperfection, donc incapable de générer une œuvre de l’esprit. « Ce n’est pas un film, c’est un algorithme qui mime l’émotion. »
Et d’ajouter, dans un plaidoyer qui oscille entre provocation et drame social : « L’IA ne tue pas seulement les emplois. Elle tue les rêves. »
Plaidoyers de la défense : entre humour, provocation et utopie
Mais la défense n’a pas dit son dernier mot. Dans un duo parfaitement rodé, Me Gravellin-Rodriguez et Me Sagnier renversent la perspective. Pour eux, le procès d’ECHO n’est qu’un symptôme : celui d’une industrie sclérosée qui panique à l’arrivée d’un nouvel acteur.
Gravellin attaque sur le terrain de la liberté de création : « On veut censurer un film parce qu’il n’a pas généré de grève, de caprices de stars ni de dépassement de budget. Depuis quand la souffrance est-elle un critère artistique ? » Et il conclut : « Ce n’est pas le cinéma qui est en danger. C’est le monopole de ceux qui le contrôlent. »
Me Sagnier, dans une plaidoirie théâtrale ponctuée d’humour musical, enfonce le clou : « Écho, ce n’est pas un film. C’est pire : c’est du cinéma. » Pour lui, la création ne dépend pas du mode de fabrication, mais de l’impact émotionnel. « Ce n’est pas qui crée qui compte. C’est pourquoi on y croit. »
Il ose même la satire : « Vous voulez du cinéma humain ? Vous avez Camping Paradis. Moi je veux des films qui osent. »
Une fiction qui révèle des fractures bien réelles
Au-delà du divertissement, le procès fictif d’ECHO touche un nerf à vif. Les tensions révélées sont bien réelles. D’un côté, les professionnels du cinéma, inquiets pour leurs métiers, leur statut, leur reconnaissance. De l’autre, une génération de créateurs qui voient dans l’IA une chance historique de renverser les barrières d’accès à la création.
La question centrale n’est pas seulement juridique. Elle est anthropologique. ECHO nous force à redéfinir ce qu’est une œuvre, une création, un film. À quel moment une histoire racontée cesse-t-elle d’être du cinéma ? Quand elle est produite par une machine ? Ou quand elle ne suscite plus d’émotion humaine ?
Ce qui est certain, c’est que le public — jury fictif de cette audience — est ressorti divisé. Fasciné. Et souvent bouleversé. Car derrière la farce, une angoisse : et si l’IA pouvait vraiment faire mieux que nous ?
En clôture de ce premier World AI Film Festival, la question posée en ouverture reste entière : l’IA est-elle l’avenir ou la fin du cinéma ?
Le procès d’ECHO n’apporte pas de réponse définitive. Mais il pose les termes d’un débat qu’il faudra bien affronter. D’un côté, une technologie capable de simuler le style, la narration, les émotions. De l’autre, une industrie qui se définit par ses collectifs humains, ses conflits, ses lenteurs… mais aussi sa magie.
Et si l’avenir du cinéma n’était ni dans la substitution, ni dans la résistance, mais dans la collaboration ? Un cinéma augmenté, pas remplacé. Un art qui intégrerait l’IA comme une nouvelle caméra, un nouveau pinceau, sans jamais renoncer à l’essentiel : l’âme humaine.
Le mot de la fin est revenu à Claude Lelouch, président d’honneur du festival, qui a annoncé le verdict — volontairement nuancé — comme un appel à la conciliation. « Le cinéma a besoin des nouvelles technologies », a-t-il affirmé, avant de préciser : « L’IA, c’est le rationnel. La création, c’est l’irrationnel. Le défi m’intéresse. Elle va me faire gagner du temps pour un 52e film. »
Le verdict fut donc un délibéré du juste milieu. Pas de condamnation, pas d’acquittement triomphal. Mais une reconnaissance implicite : l’IA est là, et elle va transformer le cinéma. À nous de décider comment.
Voici le Palmarès 2025 du WAIFF
Prix Coup de Cœur du Département
Curly — réalisé par Nicolas Prudent
Prix de la Meilleure Bible de Série
• 1er prix : White Mask—Serge Hayat
• 2e prix : SK8 — Philippe Rouin
• 3e prix : Et n’être qu’un homme — Olivier Bouffard
Prix du Meilleur Film réalisé sur Smartphone
Lost in Space — Timothée Falcon & Gabriel Jouve
Prix du Meilleur Synopsis de Long Métrage
• 1er prix : Minuit — Hannah Reveille & Jules Kensley
• 2e prix : Mr Kaplan — Amaury Hayat
• 3e prix : À ciel ouvert — Guillaume Miquel
Prix du Meilleur Film généré avec IA
• 1er prix : The Russian Sleep Experiment—Nicolas Pomet
• 2e prix : L’espace tombe sur la terre — Nicolas Russeil
• 3e prix : Thiaroye 44 — Hussein Dumbel Sow, Laura Bui et Papa Oumar Diagne